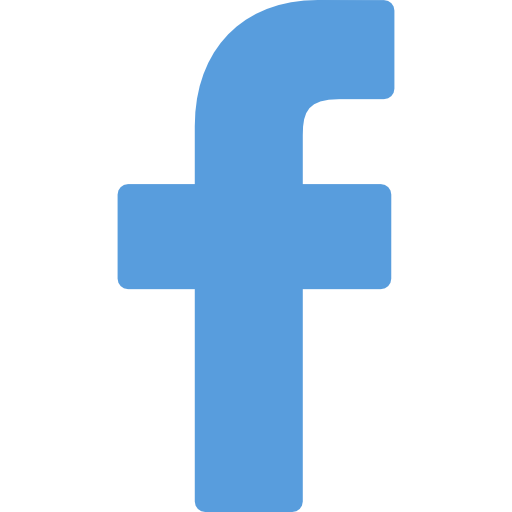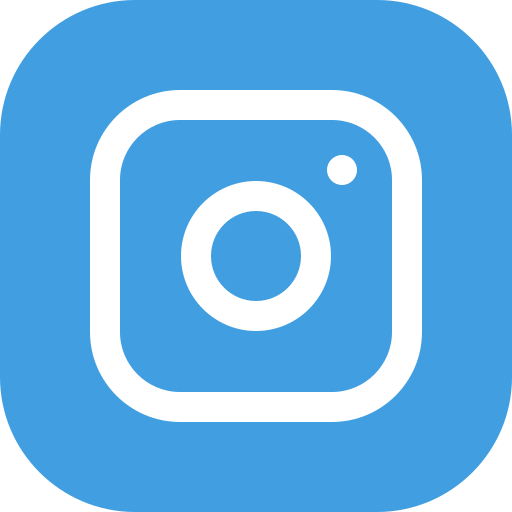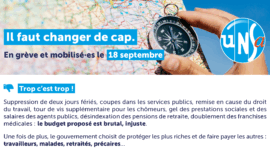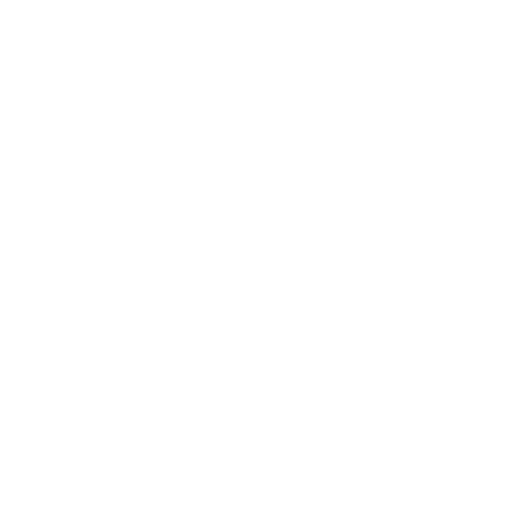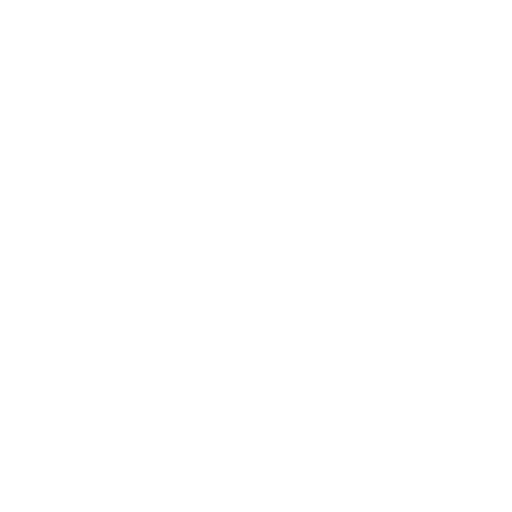Crédit Mutuel Arkéa : un projet de divorce semé d’embûches
La banque bretonne souhaite toujours prendre son indépendance du groupe Crédit Mutuel. Mais de nombreuses questions restent en suspens, après une semaine mouvementée pour Crédit Mutuel Arkéa, qui a renoncé à reprendre Socram Banque. Revue de détail.
Par Édouard Lederer – Publié le 14 oct. 2019
La semaine écoulée a été mouvementée pour Crédit Mutuel Arkéa. Mercredi, elle confirmait que sa filiale d’assurance Suravenir avait dû être recapitalisée pour affronter l’environnement de taux bas qui pénalise de nombreux assureurs. Jeudi, elle perdait une bataille juridique, la justice européenne reconnaissant définitivement le rôle de l’organe central du Crédit Mutuel (CNCM) dans la supervision de la banque bretonne . Il apparaît à présent que le projet de reprise par Arkéa de Socram Banque (actuellement détenu par la Macif, la Maif, Matmut et BPCE) n’a finalement pas abouti.
Dans le contexte explosif du projet de divorce d’Arkéa – qui cherche ardemment à quitter le groupe Crédit Mutuel – la moindre information est aussi disséquée sous cet angle : le « projet Liberté » – comme le baptise Arkéa, tient-il toujours ? « Les échanges avec les superviseurs se poursuivent en vue de finaliser le projet d’indépendance du groupe Arkéa », insiste imperturbablement Arkéa. Mais nombre de questions restent en suspens.
Que change la recapitalisation de Suravenir ?
Les montants engagés ne sont pas anodins. Selon nos informations (« Les Echos » du 9 octobre), Suravenir a dû être recapitalisée de 540 millions d’euros avant l’été par sa maison. « La solidité de la filiale reste intacte avec un nouveau résultat record attendu pour 2019 », affirme Arkéa qui revendique 7,7 milliards d’euros de fonds propres. « L’impact sur le ratio de solvabilité d’Arkéa est de 103 points de base », calcule Jérôme Legras, directeur de la recherche chez Axiom AI, soit un peu plus de 1 %. Toutes choses égales par ailleurs, le ratio de fonds propres d’Arkéa passerait ainsi de 17,5 % (à fin juin dernier), à environ 16,5 %. Mais pour tenir compte des effets d’un éventuel divorce, la Banque centrale européenne (BCE) réclame à Arkéa un niveau d’au moins 11 %. Toute tension sur le niveau de solvabilité reste donc par nature une mauvaise nouvelle. « Le ratio de solvabilité [d’Arkéa] reste très élevé, largement supérieur aux exigences réglementaires et compatible avec ses ambitions », insiste de son côté la banque mutualiste.
Le capital reste-t-il sous pression ?
Difficiles à calculer, d’autres aléas pourraient éroder le matelas de fonds propres d’Arkéa. Parmi les inconnues, la prolongation des taux négatifs par la BCE va continuer de pénaliser les assureurs. L’idée que Suravenir arrête de vendre des fonds en euros, pénalisantes en fonds propres, est évoquée. « Rien n’est décidé à ce stade. Comme chez tous les assureurs de la place, des réflexions sont en cours pour adapter l’offre aux nouvelles conditions de marché de taux durablement bas », indique seulement Arkéa.
Autre dossier à suivre, la transposition en droit européen des normes prudentielles de Bâle IV (entre 2022 et 2027) qui va se traduire par une hausse des exigences en fonds propres pour les banques européennes.
Enfin, une question à 1,7 milliard d’euros reste en suspens : cette somme, révélée en décembre 2018, est le montant de l’« indemnité » qu’exigera la CNCM en cas de divorce, si toutes les caisses du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest quittaient le groupe. Le camp breton avait alors qualifié ce chiffre de « tentative d’extorsion ».
Y voit-on plus clair sur la procédure de sortie ?
En février dernier, la CNCM a détaillé le parcours du combattant à suivre pour qui voudrait se désaffilier du Crédit Mutuel. Dans cette procédure, la CNCM est d’abord notifiée. Le cas échéant, la banque concernée sort du groupe, se retrouve sans agrément et doit le solliciter à nouveau auprès des autorités. Une séquence qui s’oppose directement à celle imaginée par Arkéa. Ses dirigeants souhaitent obtenir un avis des autorités bancaires (BCE…) sur leur projet, qui serait ensuite mis au vote en interne. La Confédération ne serait saisie qu’à la fin du processus. Pour l’heure, aucun des deux scénarios n’a été activé puisque Arkéa poursuit ses discussions avec la BCE et n’a donc pas finalisé son dossier technique. Un dialogue qui se poursuit « avec sérénité et détermination », affirme Arkéa.
Edouard Lederer