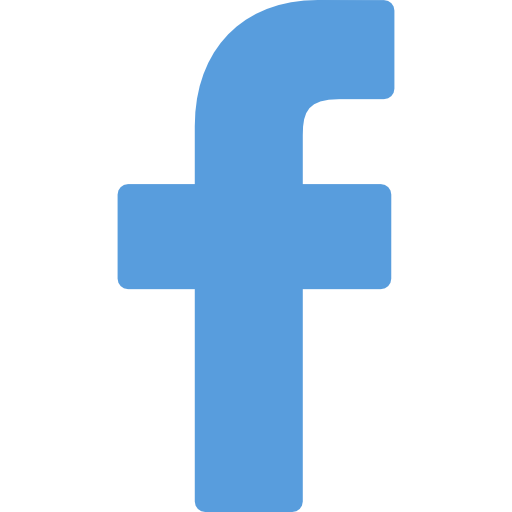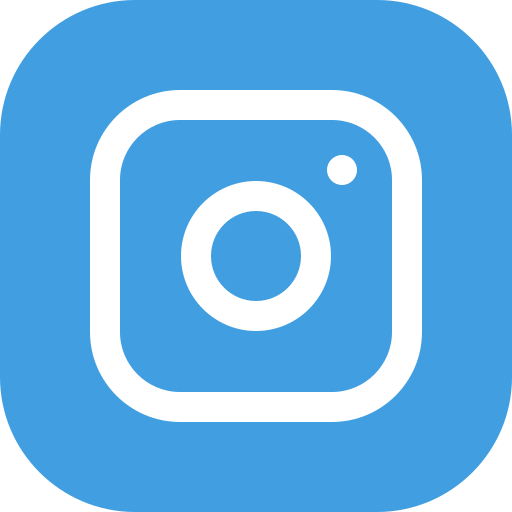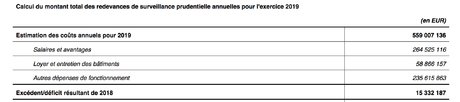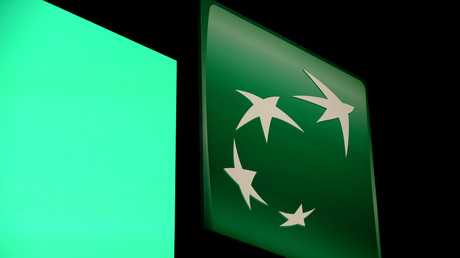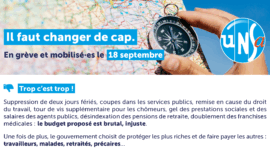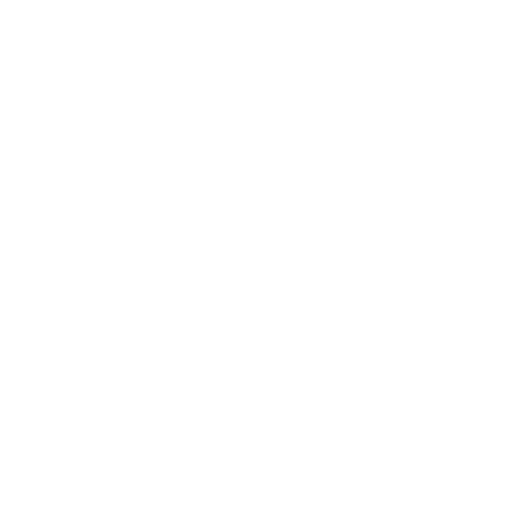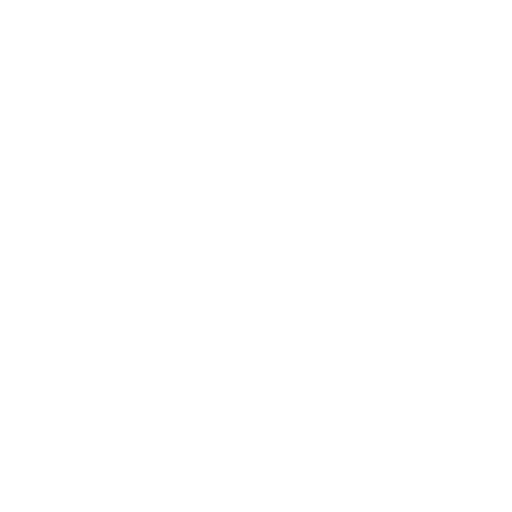Après vingt ans passés auprès de salariés en souffrance, la psychologue dénonce, dans «le Salaire de la peine», le business bien huilé du bien-être des salariés, tourné avant tout vers la performance.
Les salariés des grandes entreprises, et parfois des moins grandes, connaissent bien cette impression étrange lorsqu’au détour d’un questionnaire ou d’une formation la structure qui les emploie affiche une préoccupation pour leur bien-être. Il y a comme un décalage, comme une imposture sous-jacente difficile à identifier. Les directions des ressources humaines proposent parfois du coaching pour «gérer son stress», mettent en place une «hotline psy», organisent des «expérimentations managériales» qui vont permettre de «mettre l’humain au cœur du process» pour que les salariés, pardon, les «collaborateurs», soient épanouis. Mais aucune des solutions proposées pour régler les problèmes identifiés n’ira jusqu’à remettre en cause de façon opérationnelle l’organisation du travail qui les a fait naître.
Sylvaine Perragin travaille depuis vingt ans en tant que psychologue du travail indépendante. Dans son livre le Salaire de la peine (Le Seuil) , elle décrit un système mortifère qui a fait de la souffrance au travail un business des plus rentables. Et des plus inutiles. Car depuis la prise de conscience de l’existence de ce phénomène, notamment avec la parution en 1998 de Souffrance en Francede Christophe Dejours, et surtout après les dramatiques vagues de suicides chez Renault et France Télécom entre 2006 et 2009, des moyens ont été alloués pour lutter contre le mal-être des salariés. Pour quels résultats ? En 2014, une étude du cabinet Technologia estimait à 3,2 millions le nombre de Français en danger d’épuisement. Une autre étude de l’Institut de veille sanitaire (INVS) évaluait, en 2015, à 480 000 le nombre de salariés en souffrance psychique au travail, dont 30 000 en situation de burn-out. C’est que, selon Sylvaine Perragin, les cabinets de ressources humaines «ont fait de la souffrance au travail un véritable marché avec un produit à vendre, en l’occurrence le « bonheur au travail » pour une performance accrue».
Le Salaire de la peine est la mise en lumière implacable d’un système qui veut tout «solutionner» sans jamais rien résoudre. C’est une démonstration, nourrie d’exemples révoltants, de l’existence d’un consensus industriel autour d’une organisation du travail toxique pour les salariés. Au cœur de celle-ci, on trouve une volonté permanente d’optimiser les ressources (humaines) en fonction d’objectifs forcément chiffrés. Et quand la machine déraille, l’organisation profonde n’est jamais remise en cause. «Dictature de la bienveillance, exécration du conflit, volonté de réconcilier l’inconciliable, solutionnisme primaire, perte de lucidité, le business de la souffrance au travail véhicule l’idée d’un miracle fait de petites solutions, de techniques pour travailler sur soi, écrit Sylvaine Perragin. Comme s’il suffisait d’acquérir un peu de méthode. Vous êtes en colère ? Mettez-vous sur pause, changez votre rapport à l’autre, forcez-vous à dire au moins un compliment par semaine à chacun de vos collaborateurs, mangez cinq fruits et légumes et adonnez-vous à trente-cinq minutes de yoga.» Du yoga, on en aurait peut-être eu besoin pour se remettre de la lecture du Salaire de la peine, mais on a préféré s’entretenir avec son auteure.
Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd’hui, après vingt ans d’activité professionnelle dans ce secteur ?
C’est un effet de saturation. Je me suis spécialisée très tôt dans les problématiques de souffrance au travail. Ça s’est fait naturellement, parce que j’ai eu pas mal de salariés qui sont venus dans ma consultation de psychothérapie pour me parler de leur souffrance, au moment où on n’en parlait pas beaucoup. J’ai vite compris que les solutions ne pouvaient pas être qu’individuelles. Ce n’est pas juste de leur faute si les gens souffrent, et il ne faut pas se contenter de leur conseiller la méditation ou le yoga. Il y a une responsabilité de l’organisation du travail. J’ai commencé à aller voir les entreprises en proposant une réflexion sur leur propre organisation, du stress et des dépressions qu’elle pouvait engendrer. A l’époque, dans les années 90, personne ne prenait ça au sérieux. Mais il y a eu un moment de bascule, quand c’est devenu un marché, après les suicides chez Renault et France Télécom. De gros cabinets de ressources humaines s’en sont emparés. Les mêmes qui, avant, vendaient de la performance par le stress. Petit à petit, ils ont commencé à vendre du «bien-être» au travail, mais toujours avec le même objectif : la performance. Mais ils ne proposent pas de bonnes solutions, puisque leur objectif n’est pas de soulager cette souffrance. Il y a quelque chose de profondément toxique.
Vous dites qu’il y a aujourd’hui des «leaders du bien-être» et des «spécialistes de l’humain au travail».Comment travaillent-ils ?
Ils font ce qu’ils appellent de la «communication». Mais la communication, normalement, c’est le fait de transmettre une information. Eux, quand ils font des plans de communication, ils établissent d’abord un objectif : influencer l’opinion des salariés sur leurs conditions de travail et sur leur entreprise. Puis, en fonction de cet objectif, ils établissent une stratégie. Ça s’appelle de la «manipulation». Or les salariés ne sont pas plus idiots que la moyenne, ils le sentent. Et ils se referment. Ils peuvent y croire un temps, parce qu’ils aiment ce qu’ils font, mais ça ne dure jamais. Non seulement ces spécialistes calent leur communication sur leurs objectifs – valoriser l’entreprise et sa réussite dans tous les domaines -, mais ils veulent aussi supprimer toute négativité. Et pour ça, ils ont créé une novlangue insupportable qui instaure un décalage entre ce que ressentent les gens et ce qu’on leur renvoie. L’exemple le plus flagrant et le plus connu reste quand même le «plan de licenciements» devenu un «plan de sauvegarde de l’emploi». Ce qui est un déni de réalité et un déni de souffrance. Les gens qui sont licenciés ne sont pas dans la sauvegarde de l’emploi. C’est grave, parce qu’on perd le langage commun. Ne parler que de «sauvegarde de l’emploi», ça veut dire qu’on refuse de prendre en compte la souffrance parce que cette souffrance-là nous renvoie une mauvaise image. Et tout est décliné de cette manière-là. Le désaccord dans l’entreprise, ce n’est pas «corporate». Alors que l’opposition, c’est la vie, c’est la démocratie, c’est ce qui devrait exister dans chaque entreprise. Ça permet d’ajuster les décisions, de les enrichir… Mais non, on considère que toute opposition est nuisible !
Comme si le fait de ne pas être d’accord relevait de l’acte de sabotage…
Oui, c’est considéré comme un frein, alors que c’est l’essence même du travail : discuter ensemble des critères pour arriver de la meilleure façon à un objectif. On discute de la qualité de ce qu’on fait. Mais ça, dans beaucoup d’entreprise, c’est terminé ! Et comme on ne peut plus discuter du contenu, on ne peut plus discuter que d’une chose : le résultat. Alors que le résultat, ce n’est qu’une petite partie du travail. Le point d’arrivée est devenu l’alpha et l’oméga de toute la vie en entreprise. C’est un point d’arrivée chiffré et il est individualisé, donc il ne prend pas en compte les interactions. Alors que tout est interactif dans une entreprise, les gens sont interdépendants. Analyser le résultat du travail d’une personne, c’est le séparer de tous ses collègues. Ça n’a pas de sens, et ça sépare les gens. Ça génère des comportements déloyaux.
Vous pointez le fait qu’on réduit le monde du travail à des histoires d’individus…
Si on se met ensemble dans une entreprise, c’est justement parce qu’on ne peut pas faire les choses seuls ! Plus on individualise le travail, plus on se trompe. Comme l’explique très bien Christophe Dejours, toutes les évaluations individuelles du travail sont des entreprises de destruction du collectif. Et il y a des cabinets de ressources humaines qui vendent pour les cadres des formations pour mener des entretiens individuels, et qui vendent ensuite des séminaires de cohésion d’équipe. C’est aberrant ! La responsabilité d’un cabinet de RH, c’est de dire que ce sont justement les entretiens individuels de performance qui détruisent la cohésion et le collectif.
Vous expliquez aussi que ce résultat individuel ne prend presque jamais en compte la qualité…
Non, ce n’est souvent plus la qualité qui compte, c’est la rapidité d’atteinte de l’objectif. Ce n’est jamais dit comme ça, bien sûr, mais aujourd’hui beaucoup de travaux à l’intérieur d’un métier sont bâclés. Et ce qui se joue, dans cette exigence de rapidité, c’est l’estime de soi. On sait tous très bien lorsqu’on fait un travail de qualité. Et quand on bâcle, on le sait aussi. On peut le faire une fois, on connaît tous des pics d’activité, mais si on le fait tout le temps, on finit par voir dans son miroir quelqu’un qui ne fait pas du bon travail. Au-delà de la reconnaissance des autres, c’est l’estime de soi qui baisse. Et c’est le sens qui disparaît. Du coup, le stress monte, et on finit par se retrouver dans des formations de gestion du stress.
Vous expliquez que pour pouvoir donner du sens à son travail, il faut sentir qu’il y a une part d’irremplaçable dans ce qu’on fait…
Oui, quand une entreprise affirme que personne n’est irremplaçable, elle transforme l’être humain en machine capable d’exécuter une tâche. Or il y a une part d’irréductible à chaque être humain. Un réceptionniste dans un hôtel a sa manière à lui de faire son travail, intimement liée à sa personnalité. Il y a des règles et des procédures à suivre, mais c’est son identité métier qui compte avant tout. Et quand on lui reconnaît cette identité-là, il peut trouver du sens. C’est de ça dont les salariés ont besoin, pas de salles de massage. Ils ont besoin de faire un travail de qualité, de la façon dont eux se le représentent.
Comment en est-on arrivé à vouloir détruire ce que les gens apportent ?
Ça vient de la volonté de contrôle. L’arrivée de l’informatique y a été pour beaucoup, car elle permet de contrôler beaucoup de choses. Et elle permet surtout de tout chiffrer. Cette volonté de contrôle, c’est un désir de toute-puissance. En face, le travail, c’est vivant, et plus on essaie de réduire ce paramètre, plus les gens sont malheureux. Mais l’illusion qui persiste, c’est que plus on contrôle, plus on va être rentable. C’est peut-être parfois vrai, mais ça implique surtout d’abîmer le sens qu’on peut trouver dans son travail. Il y a une course en avant. C’est comme si on ne pouvait plus faire autrement. Et ça a un impact sur absolument tous les métiers. Même les travailleurs sociaux ou les salariés des ONG se retrouvent avec des objectifs chiffrés.
Le cynisme de cette situation, c’est qu’il y a une injonction au divertissement permanent…
Dans l’évolution du langage, on est passé de la souffrance physique à la souffrance mentale, aux risques psychosociaux, puis au stress au travail, et on a basculé dans le positif avec la «qualité de vie au travail», puis le «bien-être» au travail, et maintenant on en est au «bonheur». Et je suis persuadée que bientôt, ça fera partie des objectifs à atteindre, d’être heureux au travail. Et ceux qui ne sont pas heureux, ils commettront une faute, ils vont finir par poser problème. Ils seront sur la pente de l’exclusion.
Pour vous, les grandes entreprises sont-elles des milieux toxiques ?
Oui. Toutes. On peut trouver des îlots, des petits services où les gens s’entendent bien, mais globalement, à partir d’une certaine taille, ça devient invivable.Erwan CarioSYLVAINE PERRAGIN LE SALAIRE DE LA PEINE «Don Quichotte», Le Seuil, 192 pp., 16 €.
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/24/sylvaine-perragin-l-obligation-d-etre-heureux-au-travail-fera-bientot-partie-des-objectifs-a-atteind_1723161