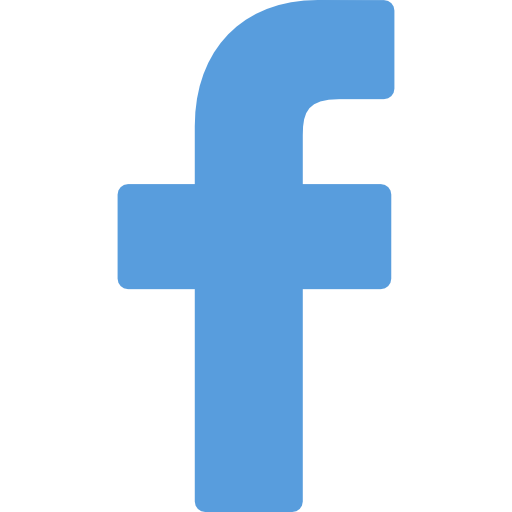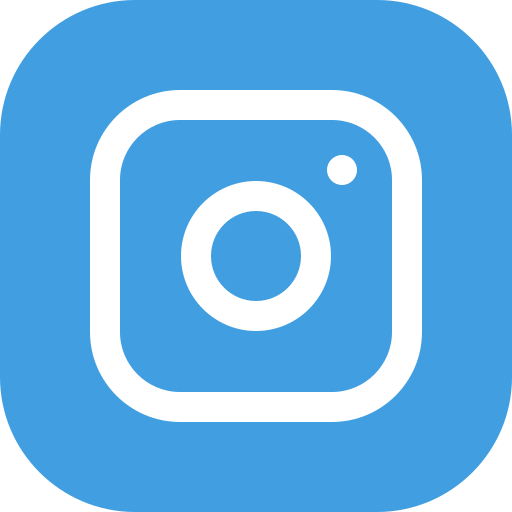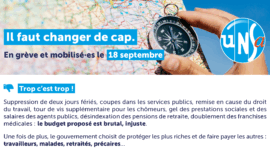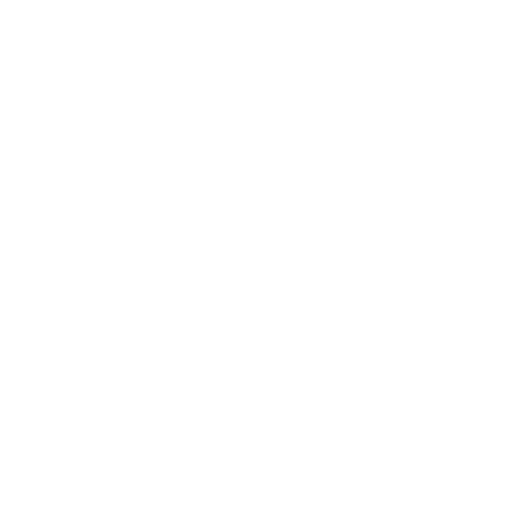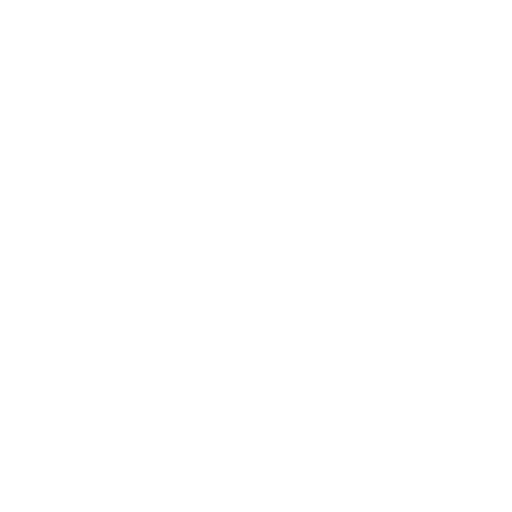L’ACPR et l’AMF distribuent leurs cartons rouges
RAPHAËLE KARAYAN | 19/06/2019
Le Pôle commun du gendarme de l’assurance et de celui des marchés financiers a publié son rapport annuel 2018 sur la protection des consommateurs.
La fraude augmente, la clientèle vieillit, le digital crée de nouvelles pratiques commerciales et de nouveaux produits… Dans ce contexte, le Pôle commun à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) veille. Les deux gendarmes ont publié ce mardi 18 juin leur rapport annuel 2018 sur la protection des clients des secteurs de l’assurance, de la banque et de l’épargne.
Ils relèvent notamment une augmentation de la fraude. 150 noms ont ainsi été ajoutés à la liste noire des acteurs qui ne sont pas autorisés à commercialiser leurs produits en France. Cette liste compte désormais 750 noms, que l’on peut trouver sur le site ABEIS(Assurance banque épargne info service). Des escrocs qui n’hésitent pas à proposer de juteux investissements dans les terres rares, les diamants d’investissement ou encore les cryptoactifs, type bitcoin (55 M€ de pertes déclarées en 2018) pour appâter le chaland, notamment par téléphone. Ce mode de démarchage « reste un maillon très efficace pour les escrocs », relève la directrice en charge des relations avec les épargnants à l’AMF, Claire Castanet. « Tout ce qui est usurpation monte aussi très fort », ajoute-t-elle, soulignant que les populations vulnérables ne sont pas les seules cibles des fraudes. « Il y a aussi des personnes éduquées financièrement qui se font avoir ».
Un guichet unique pour répondre aux questions des consommateurs
Benoît de Juvigny, le secrétaire général de l’AMF, voit dans le contexte actuel (taux très bas, défiance vis-à-vis des produits financiers) une situation « propice aux arnaques ». Les clients, séduits par des offres trop belles pour être vraies, manquent de prudence et de discernement.
Pour les aider, le Pôle commun de l’AMF et de l’ACPR a refait son site web, conçu comme un guichet unique pour les consommateurs de produits financiers et assurantiels. Outre la liste noire des acteurs ne respectant pas la réglementation, on y trouve des infos pratiques et des conseils. Plus de 750 000 visiteurs l’ont consulté l’année dernière. Les consommateurs peuvent aussi recourir à la plateforme téléphonique et poser des questions en ligne. En matière d’assurance, le premier motif d’appel porte sur la gestion de sinistre et la résiliation des contrats d’habitation ou automobiles. En assurance-vie, plus de la moitié des demandes concerne les dénouements de contrats (décès, rachat). Beaucoup de questions également sur la substitution d’assurance emprunteur et l’assurance construction.
« Il faut bannir l’auto-évaluation des connaissances financières »
La vigilance du Pôle commun vise également les pratiques commerciales des assureurs. En matière publicitaire, sa veille a passé au crible plus de 200 publicités, sur tous les canaux y compris les réseaux sociaux. Deux pratiques sont épinglées : le déséquilibre des messages sur les contrats d’assurance vie en unités de compte, qui mettent trop en avant les rendements et pas suffisamment les risques ; et la tendance au green-washing des fonds d’investissement, qui ont mis en avant la finance durable dans leurs publicités en 2018. A cet égard, Benoît de Juvigny annonce une « vague de contrôles » destinés à « soulever le capot des fonds ISR ».
Au rang des pratiques condamnables, Claire Castanet cloue au pilori « l’auto-évaluation des connaissances financières par le client », ces QCM à remplir sur les sites des banques et qui contribuent à déterminer le profil de risque du client. Elle dénonce aussi l’approche trop court-termiste des conseillers financiers, qui ont tendance à privilégier les produits à horizon de détention de 3-5 ans, manquant à leur devoir de conseil et de compréhension des objectifs du client.
L’ACPR et l’AMF ont par ailleurs l’intention de lancer cette année un groupe de travail de place pour dégager les meilleures pratiques en termes de commercialisation auprès des personnes âgées (produits, distribution, information délivrée au client, politiques de conformité, formation des réseaux).
Enfin, dans le viseur du Pôle commun en 2019, on trouve pêle-mêle la vente en ligne, les contrats d’épargne salariale en déshérence, et l’examen des pratiques commerciales « d’auto-placement » de produits financiers, consistant pour un organisme à vendre à ses clients des titres qu’il a lui-même émis (parts sociales, certificats mutualistes…). D’où un fort risque de conflit d’intérêt.