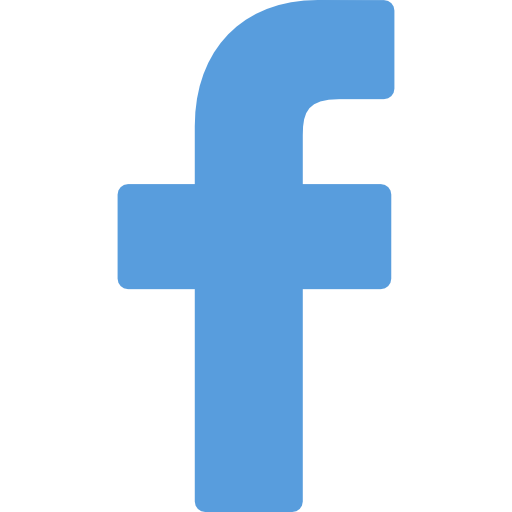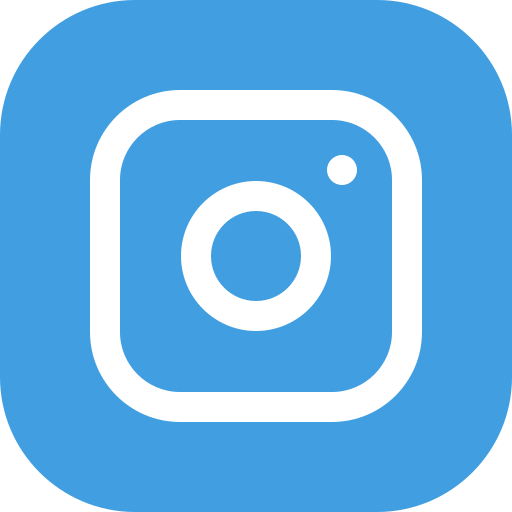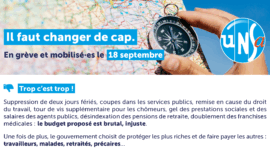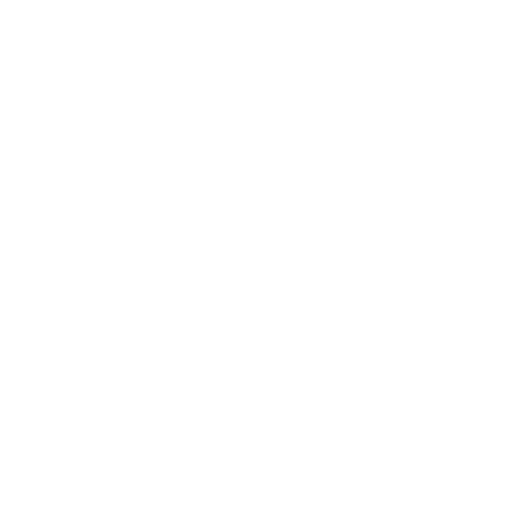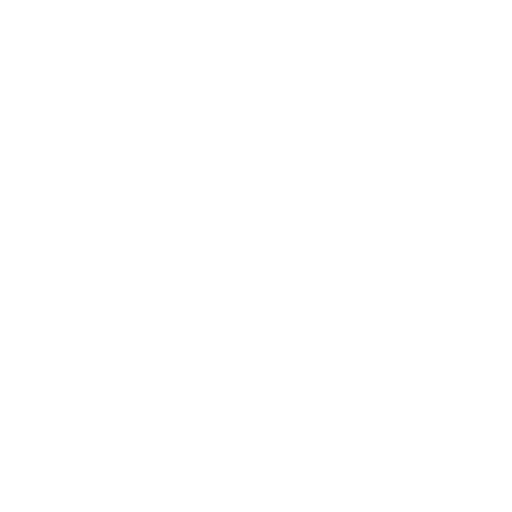ENQUÊTEC’est un paradoxe du marché du travail français : alors que les actifs sont appelés à travailler de plus en plus longtemps, les 55-64 ans ont un taux d’emploi inférieur à la moyenne de l’Union européenne.
Après environ sept ans passés dans une belle agence de communication, Sylvie Heas avait envie d’évoluer. Elle répond à une offre d’emploi qui correspond à son profil, décroche un premier entretien téléphonique. Au bout de trente minutes d’un échange positif, la recruteuse lui propose de fixer un rendez-vous. Tout se présente pour le mieux. Jusqu’à ce que, soudain, elle réalise que Sylvie Heas n’a pas précisé son âge sur son CV. Elle pose donc la question. A l’annonce de la réponse – 56 ans –, l’échange tourne court. Plus de rendez-vous en perspective. « C’est qu’au-delà de 45 ans, mon client ne veut embaucher personne…. », explique la recruteuse à la candidate interloquée.
C’est l’un des nombreux paradoxes du marché du travail français et une difficulté de taillepour la réforme des retraites en gestation. Alors que les individus sont appelés à travailler de plus en plus longtemps, les seniors – entendez par là les plus de 45 ans, selon la terminologie couramment admise dans le monde du travail… – sont les mal-aimés des entreprises et des recruteurs. Selon l’étude d’ADP The Workforce View in Europe, rendue publique début septembre, plus d’un tiers des salariés français estime avoir subi une forme de discrimination au travail liée à son âge.
Voilà pour la perception. L’examen statistique confirme ce sentiment d’inégalité.
Malgré une nette amélioration depuis une dizaine d’années, due notamment à l’arrêt des cessations anticipées d’activité (préretraites), la situation des seniors sur le marché du travail n’est guère enviable.
Le taux d’emploi des 55-64 ans s’établit à 51,3 % en 2017 en France, un niveau inférieur à celui de la moyenne de l’Union européenne (UE), où il est de 57,1 %. Pour la tranche d’âge des 60-64 ans, le décrochage français est encore plus net : 29,4 % contre 42,5 %. Le taux d’emploi est environ deux fois plus élevé en Allemagne, en Estonie, au Danemark, en Estonie, au Pays-Bas… Il dépasse même les 60 % en Suède (68 %), en Norvège (66 %) ou en Suisse (61 %)… et atteint 82 % en Islande.
« En France, seul le secteur automobile a fait de réels efforts »
Les Français seraient-ils les champions de la retraite prise le plus tôt possible ? Pas vraiment. En réalité, ce faible taux d’emploi se traduit par une très grande diversité de situations : ni au travail ni à la retraite, les seniors naviguent dans une zone grise, entre arrêts maladie, invalidité ou chômage. « Entre 55 et 64 ans, une part non négligeable des travailleurs passe par l’inactivité », souligne Marion Gilles, chargée de mission au département Etudes, capitalisation & prospective à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).
De très nombreuses sorties de la vie active sont liées à des problèmes de santé. Exigences physiques trop élevées, pression trop forte, horaires décalés, travail de nuit… tout cela accélère l’usure des salariés.
« En France, seul le secteur de l’automobile a fait de réels efforts pour adapter les postes au vieillissement des salariés », estime Marc Raynaud, président fondateur de l’Observatoire du management intergénérationnel (OMIG).
Ni au travail ni à la retraite, les seniors naviguent dans une zone grise, entre arrêts maladie, invalidité ou chômage
L’autre motif de sortie du marché du travail à partir de la cinquantaine, c’est le licenciement. « ll ne faut pas devenir chômeur quand on est senior, pointe Gérard Cornilleau, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), car alors on n’a quasiment aucune chance de retrouver un emploi. » En effet, si le taux de chômage des seniors est inférieur à la moyenne de la population, il dure beaucoup plus longtemps et les perspectives de retrouver un emploi sont minimes, particulièrement pour les femmes ou les personnes les moins qualifiées. « Que faire des salariées licenciées à 55, 56 ou 57 ans, avant qu’elles ne puissent toucher leur retraite ? Le risque est d’assister à un appauvrissement massif des vieux », s’inquiète M. Cornilleau.
En 2016, le taux mensuel de sortie des listes de Pôle emploi pour reprise d’emploi ne s’établit ainsi qu’à 1,6 % pour les 50 ans et plus, contre 6,2 % pour les moins de 25 ans, et 3,7 % pour les 25-49 ans. Le taux de sortie des listes baisse même à 1,3 % pour les plus de 55 ans, et à 1,2 % pour les 60-64 ans.
Au final, l’enjeu est donc triple : inciter les entreprises à conserver les seniors dans leurs rangs, mais en veillant à adapter les postes et les conditions de travail ; améliorer l’employabilité des seniors en continuant à former les salariés au-delà de 50 ans pour favoriser leur maintien dans les entreprises ; trouver des pistes pour faciliter le retour à l’emploi des chômeurs âgés.
Une expertise recherchée
Pour y parvenir, le préalable est sans doute de changer les mentalités et les représentations collectives des salariés matures et de leur capacité à « rebondir ». Trop rigides, pas assez agiles, trop expérimentés mais pas assez formés, trop chers, insuffisamment mobiles, planqués… Les seniors se voient accusés de bien des maux, parfois avec la plus grande mauvaise foi. Marie-Hélène Davos, 54 ans, a fait l’essentiel de sa carrière à La Poste comme cadre supérieur. Elle s’étrangle quand elle repense à cet entretien avec une recruteuse qui lui reprochait, d’un côté, d’avoir passé plus de vingt ans auprès du même employeur, et, de l’autre, « de ne pas pouvoir s’engager plus de six ans auprès d’un hypothétique nouvel employeur, puisqu’elle partirait ensuite à la retraite »…
Toutefois, on ressent un léger frémissement depuis un à deux ans. Est-ce la baisse du chômage qui laisse moins de latitude aux employeurs ? Le juste retour de balancier quand des équipes trop jeunes ont fait la démonstration de leurs limites ? La prise de conscience qu’il faudra bien « faire avec » les seniors puisque la population active vieillit inexorablement ? Les entreprises commencent à regarder cette population d’un œil plus bienveillant. Pas toutes, bien sûr : « L’évangélisation prend du temps, témoigne Amélie Favre-Guittet, la directrice de Madircom, un cabinet de conseil RH, mais les choses bougent un peu. »
Les PME, qui emploient un peu moins d’un salarié sur deux en France et qui peinent à recruter, voient arriver avec bonheur les candidatures de personnes expérimentées. Les start-up, elles aussi, commencent à se tourner vers cette population capable d’apporter une expertise qui peut manquer aux équipes. « On travaille de plus en plus avec des investisseurs qui veulent voir arriver des seniors sur des postes-clés : ressources humaines, finances, développement international », précise Mme Favre-Guittet.
Sensibilisation à la diversité générationnelle
Laurent Klein, qui vient de créer une entreprise sociale et solidaire, Bounce-in-Blue, dont le projet est de remettre le pied à l’étrier aux cadres en inactivité par le biais du management de transition, approuve. Pour lui, beaucoup de start-up ou de très petites entreprises sont intéressées par « la séniorité, l’expérience ». Sans aller jusqu’à embaucher des seniors en CDI : la formule qu’il propose, celle de confier des missions à des cadres confirmés, convient bien à sa clientèle encore frileuse. Les grandes entreprises, particulièrement dans l’industrie, ont aussi besoin d’expertises pointues, que seule permet une longue expérience.
A la tête du cabinet Expering, Jean-Charles Marcos fournit des intérimaires de haut vol à des entreprises de défense, de transport, de BTP, d’aéronautique… « Un expert du béton appliqué à la construction de centrales nucléaires, il n’y en a pas quarante en France, explique-t-il. Les entreprises sont prêtes à renforcer leurs équipes avec des gens âgés, mais sur les postes techniques. En revanche, sur les postes de management, c’est plus compliqué…. » La rémunération, si elle n’est pas justifiée par une expertise particulière, reste un obstacle à l’embauche, comme le reconnaissent à mi-voix les recruteurs.
Rares sont encore les grands groupes qui ont opté pour une réelle politique de développement de l’employabilité des catégories les plus âgées. Lorsque cette politique existe, elle organise surtout la transmission des compétences, avec des formes de mentorat ou de tutorat, comme au sein du groupe Airbus ou chez Total. D’autres groupes ont mis en place des programmes de sensibilisation à la diversité générationnelle, tel « Octave », lancé chez Danone.
« La question de maintenir en emploi les seniors ne constitue pas une priorité d’action dans les entreprises, remarque à ce sujet Marion Gilles, de l’Anact. Elles peuvent cependant s’engager dans des politiques plus actives de prévention si elles comprennent que cela a un lien avec d’autres problématiques, comme l’absentéisme ou la démotivation. »
« Deuxième partie de carrière »
Chez Saint-Gobain, où l’on aime mieux parler de « deuxième partie de carrière » que de seniors, les plus de 45 ans font l’objet d’une attention particulière. Entretiens orientés vers leurs souhaits d’évolution en termes de métier ou de fonction, suivi médical spécifique, formations (y compris sessions de préparation à la retraite…), aménagement des conditions de travail, et enfin mentorat inversé (reverse mentoring), où ce sont les plus jeunes qui initient les plus âgés aux joies du numérique et autres avancées technologiques.
« L’entreprise d’aujourd’hui est une entreprise où se confrontent trois générations, et les juniors qui arrivent ont des choses à apprendre… mais eux aussi peuvent apporter des choses aux autres générations », argumente Régis Blugeon, son directeur des ressources humaines France. C’est sans doute aussi un enjeu crucial pour un groupe qui compte un tiers de salariés de plus de 45 ans, sur un effectif de 43 000 collaborateurs en France, que de pouvoir les faire évoluer et monter en compétences.
A la Française des jeux, où l’on prête également une attention particulière à cette catégorie, l’accent est mis sur la formation. « Les collaborateurs de 50 ans ont encore quinze ans de vie professionnelle devant eux, c’est une bonne raison pour continuer à les faire bénéficier de formations de développement de leurs compétences », explique Pierre-Marie Argouarc’h, directeur Expérience collaborateur et transformation du groupe FDJ. Désormais, il est obligatoire pour les seniors de se former au moins une fois par an – le groupe a renforcé le catalogue à leur intention – et n’hésite pas à recruter des seniors.
M. Argouarc’h y voit un avantage majeur : faciliter la gestion des emplois à moyen terme. « J’ai embauché un homme de 57 ans à un poste difficile à pourvoir, explique-t-il. Je sais qu’il partira à la retraite à 62 ans, donc je sais quand je dois lui trouver un remplaçant. » Avec en prime la certitude qu’il ne sera pas débauché entre-temps par un concurrent.
Les entreprises vont-elles pouvoir faire l’économie d’une véritable réflexion sur la place des seniors dans leurs organisations ? Aller au-delà de l’idée de la transmission pour réellement capitaliser sur l’expérience, les compétences des seniors, et leur loyauté vis-à-vis des employeurs ? Dans un rapport publié fin août (Ageing and Employment Policies, Working Better with Age), l’OCDE avance également des pistes en matière de politique publique : éviter que les allocations de chômage soient utilisées comme alternatives à la préretraite, inciter les entreprises à recruter des seniors, travailler sur leur employabilité. Des politiques qui, si elles sont bien mises en œuvre, fonctionnent « dans le sens attendu », selon l’OCDE.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/15/emploi-des-seniors-un-leger-fremissement_5510707_3234.html