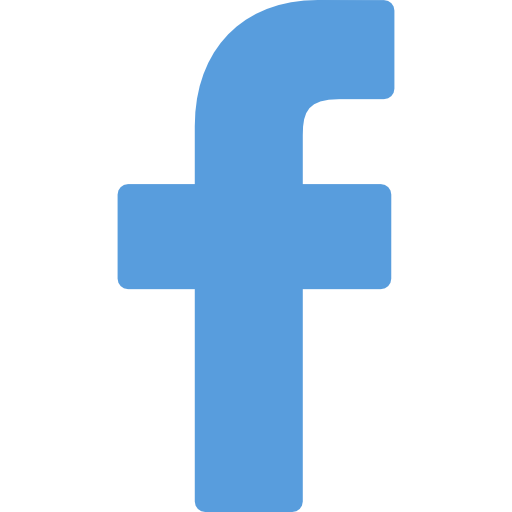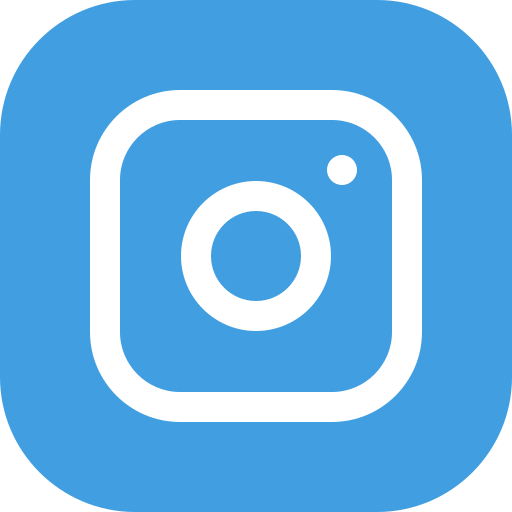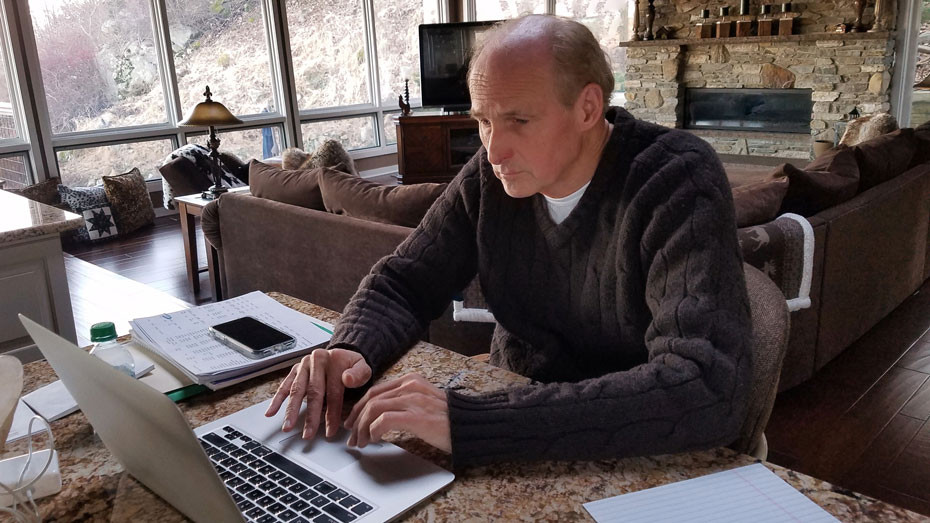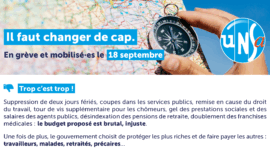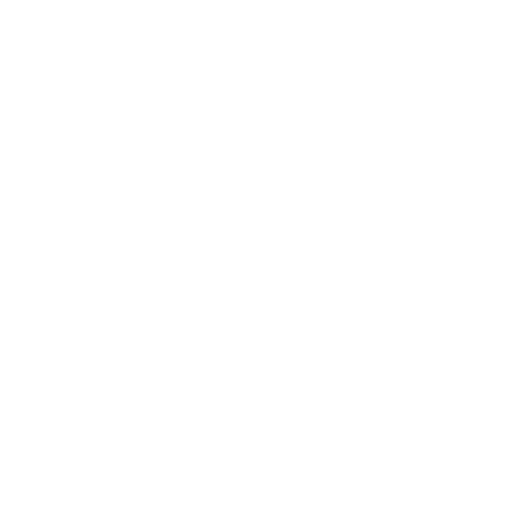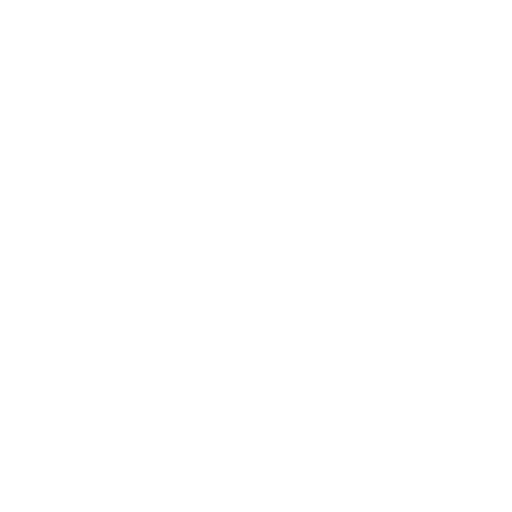PAR NOLWENN WEILER – 22 MARS 2018
Les nouvelles méthodes de management se prétendent au service de l’épanouissement des salariés, de leur « savoir être » et de la « réalisation de soi » en entreprise. Danièle Linhart, spécialiste de l’évolution du travail et de l’emploi, démonte ces impostures et montre comment le management moderne s’inscrit dans la lignée du travail à la chaîne théorisé par Taylor et Ford pour toujours mieux asservir les salariés. Objectif : déposséder les travailleurs de leurs savoirs et de toute forme de pouvoir dans l’entreprise. « Le patronat ne veut surtout pas que la contestation massive qui s’est exprimée en 1968 ne se reproduise », explique-t-elle. Entretien.
Basta ! : L’histoire du travail salarié est celle, dîtes-vous, d’une dé-professionnalisation systématique des travailleurs. Taylor a initié cette dynamique avec son « organisation scientifique du travail » au 19ème siècle qui, loin d’être neutre, visait à contrôler les ouvriers. Comment cette dé-professionnalisation a-t-elle été imposée ?
Danièle Linhart [1] : Taylor avait identifié le fait qu’au sein des entreprises, le savoir, c’est aussi le pouvoir. Sa théorie : si on laisse entièrement le savoir aux ouvriers dans les ateliers, alors les employeurs sont privés du pouvoir. Ce qui, bien entendu, serait dommageable à la profitabilité des entreprises. A l’époque, c’est à dire à la fin du 19ème siècle, lorsqu’un capitaliste décide de monter une entreprise, il possède l’argent, mais pas la connaissance ni les savoir-faire. Pour produire, il fait donc appel à des ouvriers et des compagnons qui organisent eux mêmes le travail.
La grande invention organisationnelle de Taylor consiste à ce que la direction puisse réunir – et s’approprier – l’ensemble des connaissances détenues par les ouvriers, les classer, en faire la synthèse, puis en tirer des règles, des process, des prescriptions, des feuilles de route. Bref, in fine, à ce que la direction puisse dire aux ouvriers en quoi consiste leur travail. Il s’agit d’un transfert des savoirs et du pouvoir, des ateliers vers l’employeur, et d’une attaque en règle visant la professionnalisation des métiers.
Quelles sont les conséquences de ce processus ?
Cette réorganisation fait émerger de nouveaux professionnels, des ingénieurs et des techniciens. Ceux-ci ont une masse de connaissances et d’informations à gérer et à organiser, afin de mettre en place des prescriptions de travail, à partir des connaissances scientifiques de l’époque. On a donc pris l’habitude de présenter le taylorisme comme une organisation « scientifique » du travail, sachant qu’à partir du moment où la science décide, ce qui en ressort est nécessairement impartial et neutre.
C’est évidemment faux : l’organisation du travail proposée par Taylor, qui était consultant au service des directions d’entreprises, est profondément idéologique. Elle a systématiquement et sciemment dépossédé les ouvriers de ce qui fonde leur force, leur identité, et leur pouvoir : le métier et ses connaissances. L’objectif est d’installer une emprise sur les ouvriers, de façon à ce qu’ils ne travaillent pas en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts, mais en fonction de ce qui est bon pour les profits de l’entreprise et l’enrichissement de leur employeur.
Il semble pourtant décisif pour Taylor de faire apparaître cette dépossession comme juste et honnête. Henry Ford, qui instaure le travail à la chaîne quelques années plus tard, se présente lui aussi comme un bienfaiteur de l’humanité. Quels arguments avancent-ils pour convaincre l’opinion publique ?
Taylor a toujours prétendu se situer du côté du bien commun : il affirme avoir permis une augmentation de la productivité dont toute la nation américaine a profité, alors même qu’il préconise de répartir les énormes gains de productivité obtenus grâce à son organisation du travail de manière très inégalitaire : 70 % pour l’entreprise – c’est à dire pour les actionnaires – et 30 % pour les salariés. Il dit aussi avoir « démocratisé » le travail, en l’éloignant des syndicats de métiers. Selon lui, grâce aux prescriptions définies par la hiérarchie, n’importe quel paysan pourrait désormais devenir ouvrier. Il assume totalement le fait d’avoir dépossédé les ouvriers de leur travail. Et donc, d’une partie de leur dignité.
Quelques années plus tard, Ford se présente aussi comme un bienfaiteur de l’humanité, alors qu’il propose un système technique et organisationnel encore plus contraignant. Le travail à la chaîne, c’est un pas supplémentaire vers l’asservissement. Les salariés sont non seulement tenus par des prescriptions et feuilles de route produites par la direction et sur lesquelles ils n’ont pas de prise. Ils sont désormais tenus par le rythme – infernal – imposé par la chaîne. Ford disait : « Grâce à moi, tout le monde pourra avoir sa voiture. Je participe à la cohésion sociale, et c’est un progrès formidable. »
Pourtant, chez Ford, les ouvriers étaient exploités encore plus durement qu’au sein des autres usines…
Effectivement. Le rythme y était tel qu’ils étaient très nombreux à jeter leurs outils sur la chaîne, en assurant qu’il était impossible de travailler à de telles cadences. En 1913, plus de 1300 personnes par jour doivent être remplacées ! Le taux de rotation avoisine les 380 %, ce qui est trop élevé pour assurer la production et tirer les profits escomptés. Pour fixer les ouvriers, il décide alors d’augmenter les salaires, jusqu’à ce qu’ils restent. Résultat : les paies sont multipliées par 2,5. Ce qui est énorme pour l’époque, évidemment. Ford présente cette augmentation de salaire, mise en place pour faire supporter des conditions insupportables, comme un véritable progrès social. Il fait croire à un scénario « win win », comme disent les managers aujourd’hui : tout le monde serait gagnant, l’employeur comme les salariés.
Ford pousse la logique d’exploitation plus loin que Taylor. Y compris à l’extérieur de l’atelier. Il se préoccupe d’entretenir et de reproduire « la force de travail » jusque dans la vie quotidienne des ouvriers. Quelle forme cette stratégie prend-t-elle ?
Pour tenir le coup lorsqu’ils travaillent à la chaîne, les ouvriers doivent littéralement mener une vie d’ascète. Henry Ford créé un corps d’inspecteurs chargés d’aller vérifier qu’ils se nourrissent bien, qu’ils dorment correctement, qu’ils ne se dépensent pas inutilement, qu’ils ont un appartement bien aéré… Ford, qui était végétarien, propose même des menus à ses ouvriers. Il exerce une véritable intrusion dans la vie privée, officiellement pour le bien des salariés.
On retrouve le même discours dans le management du 21ème siècle, qui prétend répondre aux aspirations les plus profondes des salariés : « Vous allez être contents de travailler chez nous. Vous verrez, nous allons vous faire grandir. » Il faut avoir du courage, être audacieux. Entretenir son corps. Dans certains bureaux, on peut désormais travailler sur ordinateur tout en marchant, grâce à des tapis roulant ! Les DRH parlent de bienveillance et de bonheur, comme Ford le faisait avec ses inspecteurs. La volonté de prise en charge de la vie des salariés perdure.
Comment se manifeste cette intrusion, dans l’entreprise du 21ème siècle ?
On leur propose par exemple des massages, de la méditation, des activités destinées à créer des relations avec leurs collègues. Certaines entreprises distribuent des bracelets pour que les salariés puissent comptabiliser leurs heures de sommeil. C’est très intrusif. L’organisation moderne du travail est un perfectionnement des méthodes de Taylor et de Ford : les directions s’occupent de tout, tandis que les salariés s’engagent totalement pour leur entreprise, avec l’esprit « libéré ».
Il s’agit toujours de faire croire aux salariés que cela est réalisé l’est pour leur bien. La logique du profit, la rationalité capitaliste deviennent l’opportunité pour les salariés de faire l’expérience de leur dimension spécifiquement humaine. D’ailleurs, les qualités qui leur sont demandées relèvent de dimensions qui vont au delà du professionnel : il s’agit de l’aptitude au bonheur, du besoin de se découvrir, de la capacité à faire confiance, à mobiliser son intuition, son sens de l’adaptation, à faire preuve de caractère, d’audace et de flexibilité…. La notion de « savoir être » est d’ailleurs devenue l’un des axes forts de la nouvelle gestion des salariés préconisée par le Medef.
La dépossession professionnelle mise en place par Taylor plonge les salariés dans un état de soumission et de dépendance hiérarchique inouï pour l’époque, dîtes-vous. Le management contemporain impose-t-il la même chose ?
Avec le taylorisme, les salariés ne peuvent plus travailler sans les préconisations de leurs supérieurs, comme les gammes opératoires, les délais alloués… On retrouve cela dans le management actuel, bien entendu, puisque le travail reste défini par les directions, assistées de cabinet de conseils qui élaborent des procédures, des protocoles, des « bonnes pratiques », des méthodologies, des process… Les salariés n’ont aucune prise sur cette définition. La dictature du changement perpétuel accentue même cette dépendance. Dans toutes les entreprises – que ce soit dans l’industrie ou dans les services – on change régulièrement les logiciels, on recompose les services et départements, on redéfinit les métiers , on organise des déménagements, on externalise, puis on ré-internalise… Ce faisant on rend les connaissances et l’expérience obsolètes. On arrive même à transformer de bons professionnels en apprentis à vie ! Les gens sont perdus.
Les salariés le disent d’ailleurs de manière très explicite : « Je ne sais plus où je suis dans l’organigramme. Je ne sais pas de qui je dépends. » Ils sont totalement déstabilisés, se sentent en permanence sur le fil du rasoir et se rabattent sur les procédures et les méthodes standard, comme sur une bouée de sauvetage. Mais ces procédures et méthodes standard ne sont définies et maîtrisées que par les directions… Les salariés se retrouvent en proie à des doutes terribles. Ils se sentent impuissants, incompétents. Ils sont obligés de mendier des aides techniques. Leur image de soi est altérée. Ils ont peur de la faute, de faire courir des risques à autrui. Ces méthodes les jettent dans une profond sentiment d’insécurité.
Face à cette exigence du changement permanent, les anciens apparaissent comme embarrassants. Vous expliquez que leur expérience est disqualifiée et leur expertise oubliée. Comment cette disqualification se met-elle en place ?
Il faut éviter, quand on est manager, d’avoir des gens capables d’opposer un autre point de vue en s’appuyant sur les connaissances issues d’un métier ou de leur expérience. Si un salarié revendique des connaissances et exige qu’on le laisse faire, c’est un cauchemar pour une direction. Or, les seniors sont les gardiens de l’expérience, ils sont la mémoire du passé. Ça ne colle pas avec l’obligation d’oublier et de changer sans cesse. Il y a donc une véritable disqualification des anciens. On véhicule l’idée qu’ils sont dépassés, et qu’il faut les remplacer.
Il s’agit en fait de déposséder les salariés de leur légitimité à contester et à vouloir peser sur leur travail, sa définition et son organisation. L’attaque contre les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se situe dans cette même idéologie de dépossession. Ils constituaient en effet des lieux de constitution de savoirs experts opposables au savoir des directions. Les seuls savoirs experts qui doivent désormais « légitimement » exister sont ceux portés par les équipes dirigeantes où se trouvent des gens issus des grandes écoles, secondés par des cabinets de consulting internationaux.
La destruction des collectifs de travail, et le développement de l’individualisation dans la gestion des « ressources humaines », s’inscrivent-ils dans cette même ligne idéologique ?
Évidemment. C’est particulièrement vrai en France où l’individualisation systématique de la gestion des salariés a été enclenchée par le patronat au milieu des années 1970, avec toujours cette excuse officielle de la prise en compte des aspirations profondes des salariés et de leur besoin d’autonomie. Cela s’est fait en réaction aux mobilisations de 1968. Il y a eu du côté du patronat une peur très forte de la capacité de contestation massive qui s’est exprimée en 1968, sous la forme de trois semaines de grève générale avec une occupation des usines. Ce moment a été d’une violence inouï pour les chefs d’entreprise qui ne veulent surtout pas que cela se reproduise.
Depuis, tout a été mis en place pour individualiser la relation entre les entreprises et les salariés, et la relation de chacun à son travail. On a instauré des primes et des augmentations de salaire individualisées, ainsi que des entretiens individuels qui mettent le salarié seul face à son employeur pour définir des objectifs individuels – assiduité, disponibilité, qualité de la coopération avec les autres, attention aux ordres, implication, augmentation de la productivité, et j’en passe…
Il y a une mise en concurrence systématique des salariés entre eux, qui auront en retour tendance à se méfier des autres, considérés comme responsables d’une situation générale défavorable. Sans le recours possible aux autres, sans leur complicité et leur aide, voire en concurrence avec eux, les salariés auront à affronter seuls les pénibilités, la dureté de ce qui se joue au travail. Le travail n’est plus une expérience socialisatrice, il devient une expérience solitaire. L’équation « à travail égal salaire égal » est terminée. À des postes semblables, on retrouve désormais des gens qui ont des formations différentes, des statuts différents, des salaires différents. Il n’y a plus cette logique collective reliée au fait que l’on subit les mêmes conditions.
Vous ajoutez que, en mettant en avant les « aspirations » profondes des salariés, qui iraient supposément dans le même sens que les besoins de l’entreprise, on met de côté l’enjeu politique que recèle le travail. En quoi cette mise de côté, qui a commencé avec l’avènement du taylorisme, persiste-elle aujourd’hui ?
Avec son organisation « scientifique » du travail, Taylor prétendait éradiquer toute une partie de la réalité, à savoir l’existence d’intérêts divergents entre salariés et patrons, l’existence de rapports de force, et la nécessité pour les ouvriers de disposer de contre-pouvoirs afin d’échapper à la domination et de faire valoir leurs intérêts. « Mon but unique, disait-il, est d’en finir avec la lutte stérile qui oppose patron et ouvriers, d’essayer d’en faire des alliés. » On est dans la dictature du consensus.
En France, à partir des années 1980, on s’est mis à parler de consensus dans l’entreprise, avec l’idée de la « pacifier ». Il faut « créer une communauté » et que tout le monde se sente solidaire, rame dans le même sens. Il s’agit là d’une escroquerie idéologique, puisqu’il est évident que les salariés ont des intérêts à défendre, qui divergent de ceux des employeurs : la prise en compte de leur santé, la préservation de leur temps de vie privée, le fait de travailler dans des conditions qui correspondent à leurs valeurs et à leur éthique. Aujourd’hui, on tente d’effacer l’idée même du conflit. Toute idée de controverse, de contradiction, d’ambivalence est désormais disqualifiée. Il s’agit, là encore, de discréditer l’idée même de contestation et d’opposition, voire de la supprimer.
Les nouvelles méthodes de management qui se déversent dans les entreprises ne se fondent pas sur une logique innovante, mais sur une application stricte et exacerbées du taylorisme. Chacun doit faire usage de lui-même selon des prescriptions édictées par les directions. Le « Lean management » [littéralement gestion « maigre », souvent traduit par gestion « au plus juste », ndlr], qui sévit de l’hôpital aux usines, a cette ambition : faire toujours mieux avec moins en utilisant des procédures et des protocoles pensés en dehors de la réalité du travail. On demande un engagement personnel maximal, avec la menace permanente de l’évaluation, dans un contexte où la peur du chômage pèse lourd. Tout cela crée beaucoup de souffrances. Qui persistent durant la vie hors travail, entravant le repos, la détente, les loisirs, en occupant sans cesse l’esprit.
Cet « enfer », dîtes vous, est très difficile à critiquer, notamment à cause de la théorie du changement incessant, pourquoi ?
Dans le management moderne, la critique est par définition archaïque. On vous oppose le fait que vous ne comprenez pas, que tout change sans cesse. Les gens qui n’adhèrent pas sont considérés comme étant dépassés. Ou bien comme des lâches qui n’acceptent pas de se remettre en question, de prendre des risques. D’ailleurs, le modèle militaire est très inspirant pour les managers. Des hauts gradés sont régulièrement invités dans leurs colloques et formations.
Mais l’archaïsme aujourd’hui, à mon sens, réside au contraire dans le modèle de subordination du salariat. Les citoyens ont une ouverture d’esprit, des compétences et un niveau d’information qui se sont démultipliés ces dernières années. Pourtant, aujourd’hui comme hier, dès que vous mettez les pieds dans l’entreprise, vous devenez assujetti d’office à la direction. Les syndicats ne semblent pas vouloir se risquer à remettre en question ce rapport de subordination, parce qu’ils ont intériorisé l’idée que c’est lui qui oblige les employeurs à respecter les droits, les protections et les garanties arrachés au cours des luttes. Mais, devrait-on objecter, si les salariés ont des droits c’est parce qu’ils travaillent, et que cela présente des risques. Il y a là une déconstruction à faire : il ne s’agit pas de remettre en cause le salariat, bien au contraire, mais d’exiger des droits et protections plus forts encore tout en revendiquant la suppression du lien de subordination qui est une entrave insupportable et injustifiée, qui étouffe la qualité, l’efficacité et la créativité du travail.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
[1] Sociologue, auteure de nombreuses enquêtes et ouvrages (dont le dernier, La comédie humaine du travail.
De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, est paru en 2015 aux éditions Érès), Danièle Linhart est directrice de recherche au CNRS, professeure à l’université de Paris-Nanterre.
https://www.bastamag.net/La-dictature-du-changement-perpetuel-est-le-nouvel-instrument-de-soumission-des